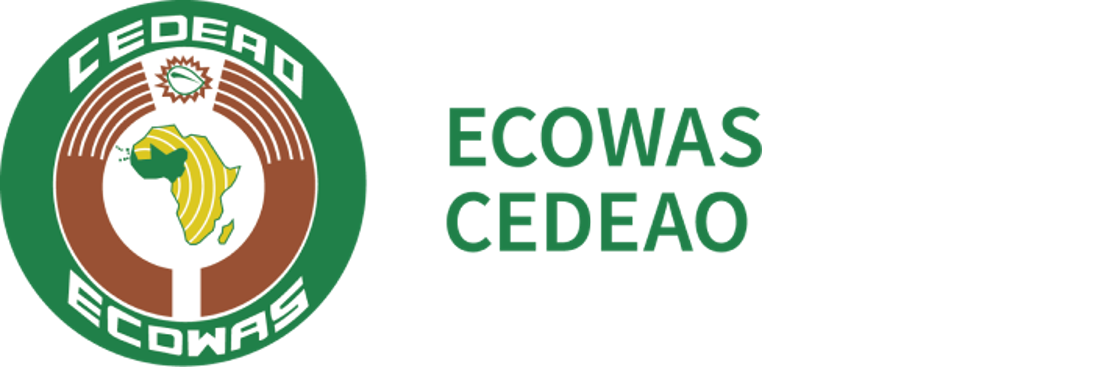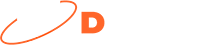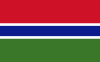Une mission de haut niveau de la CEDEAO en Guinée pour un plaidoyer en faveur de la sauvegarde du Massif du Fouta Djallon.
06 Juin, 2024Du 26 mai au 02 juin 2024, Mme Massandjé TOURE-LITSE, Commissaire de la CEDEAO en charge des Affaires Economique et l’Agriculture, accompagnée de Son Excellence M. Louis Blaise AKA-BROU, Représentant Résident de la CEDEAO en Guinée et de toute l’équipe du Programme d’Aménagement Intégré du Massif du Fouta Djallon basé à Conakry, a participé à une mission de haut niveau de plaidoyer pour la sauvegarde du Massif du Fouta Djallon.
L’initiative portée par l’Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture (FAO), en partenariat avec la Stratégie Intégrée des Nations Unies pour le Sahel (UNISS), du Programme Alimentaire Mondial (PAM) et la CEDEAO, a été hautement accueillie par les plus hautes autorités de la République de Guinée. La délégation qui a porté la voix du Massif du Fouta Djallon à travers « l’APPEL DE LABE POUR LA SAUVEGARDE DU MASSIF DU FOUTA DJALLON ET LA GRANDE COALITION SUR L’EAU POUR LE SAHEL » était composée du Secrétaire Général Adjoint, Envoyé Spécial du Secrétaire Général de l’ONU pour le Sahel, Coordonnateur de UNISS, M. Abdoulaye Mar DIEYE, du Coordonnateur du Bureau Sous-régional Afrique de l’Ouest de la FAO, M. Robert GUEI, du Représentant Résident de la FAO à Conakry, du Représentant du Bureau Régional Afrique de l’Ouest du PAM, M. Ollo SIB, tous accompagnés d’une forte délégation et des représentants des différents ministères Guinéens impliqués dans la gestion du Massif du Fouta Djallon
La mission a alterné entre rencontres avec les autorités Guinéennes, visites de terrain et actions de sensibilisation auprès des communautés qui résident aux pieds des têtes sources du Massif du Fouta Djallon. Partout, les autorités locales des régions de Labé et de Mamou ont salué l’initiative et rappelé les multiples actions déjà entreprises par l’Etat Guinéen.
Le constat de la fragilité du Massif et les enjeux de sa survie sont perceptibles. En effet, la dégradation accentuée des ressources naturelles et la situation précaire des populations qui y vivent sont autant de défis à relever pour permettre au massif du Fouta Djallon de jouer pleinement son rôle de source des principaux fleuves qui arrosent notre espace communautaire et au-delà (Fleuve Sénégal, Fleuve Niger, Fleuve Gambie entre autres).
Le plaidoyer avait pour objectif d’alerter sur l’état de dégradation avancée du Massif du Fouta Djallon et de ses impacts sur toute la région ouest africaine et de l’urgence de prendre en charge la sauvegarde de ce patrimoine naturel qu’il urge de placer au rang de patrimoine mondial de l’humanité selon M. Adoulaye Mar DIEYE, Secrétaire Général Adjoint de l’ONU, Envoyé Spécial au Sahel.
Madame Massandjé TOURE-LITSE, Commissaire des Affaires Economiques et de l’Agriculture de la CEDEAO a réitéré les remerciements de Son Excellence Dr Omar Alieu TOURE, Président de la Commission de la CEDEAO, aux autorités Guinéennes lors de la rencontre avec le Premier Ministre, S.E. Monsieur Amadou Ouri BAH, et rappelé l’engagement de la CEDEAO aux côtés de la Guinée pour la préservation du Massif du Fouta Diallon et ce depuis le transfert du Programme Régional d’Aménagement Intégré du Massif du Fouta Djallon (PRAI-MFD) de l’Union Africaine à la CEDEAO le 24 octobre 2018 sur la base du principe de subsidiarité avec la mise en place de l’Unité de Coordination du Programme par la CEDEAO.
Rappelons que le Massif du Fouta Djallon (MFD) est constitué de plusieurs hauts bassins qui sont situés au centre de la République de Guinée et se prolongent en Guinée Bissau, au Mali, au Sénégal et en Sierra Leone avec plus 8000 sources qui arrosent plus 1600 cours d’eau dont 13 transfrontaliers. Ce massif constitue la source de plusieurs grands fleuves internationaux en Afrique de l’Ouest, dont le Fleuve Gambie, le Fleuve Niger et le Fleuve Sénégal, ainsi que de nombreuses rivières.
Aujourd’hui ce patrimoine naturel transfrontalier subit une dégradation accélérée de ses ressources naturelles par suite du changement climatique et de l’intervention humaine par des pratiques qui ne garantissent pas la survie de la biodiversité (culture sous brûlis, coupes abusives de forêts, la réduction du couvert végétal, l’érosion des sols, les feux de brousse, et les effets cumulés du changement climatique etc.).